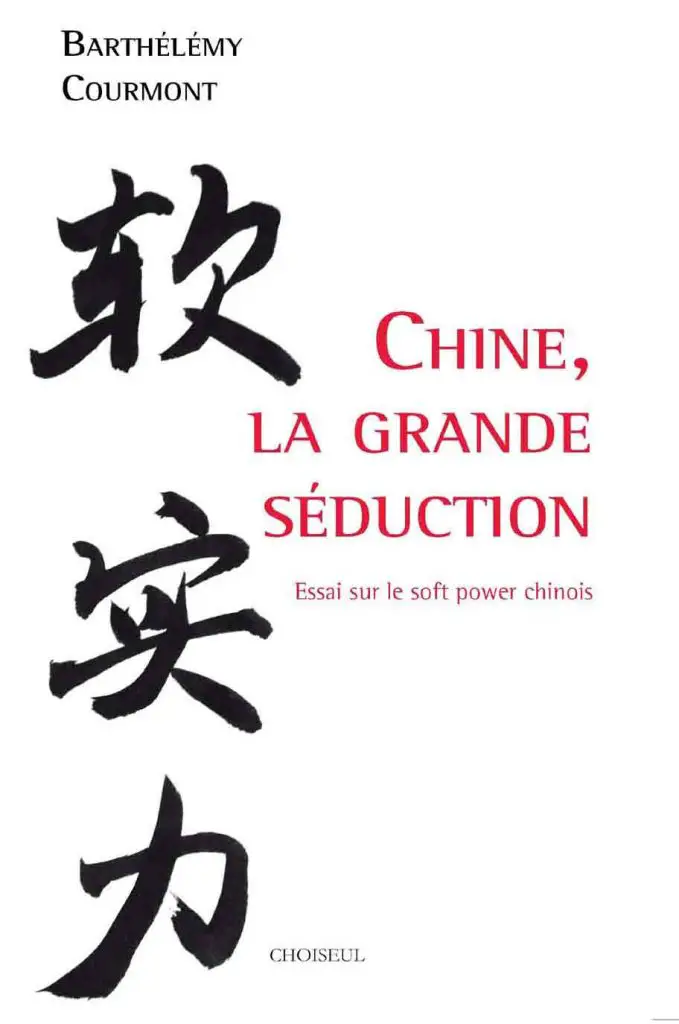

Chercheur associé à l’IRIS, et rédacteur en chef de la revue Monde Chinois, Barthélémy Courmont écrit et analyse les enjeux politiques et sécuritaires en Asie du Nord-est, la stratégie de puissance de la Chine, la politique étrangère des États-Unis, la politique américaine en Asie-Pacifique, les questions nucléaires et les nouvelles menaces.
Barthélémy Courmont, auteur de « Chine, la grande séduction. Essai sur le soft power chinois » a accordé une interview à Céline Tabou, en janvier 2011, dans laquelle, il explique comment le soft-power est destiné en premier lieu aux chinois eux-mêmes et pas seulement la politique étrangère.
Pouvez-vous en quelques mots nous raconter votre parcours ?
Après des études d’histoire à Paris 7, une formation en études de défense à Paris 2 et un an d’études à l’université Columbia de New York (à la School of International and Public Affairs), j’ai soutenu un doctorat en science politique sur le processus décisionnel ayant précédé l’utilisation de la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki en 1945.
Les recherches sur cette thèse qui se sont échelonnées sur plusieurs années m’ont conduit à travailler conjointement sur les questions nucléaires, la politique étrangère des États-Unis, et les problèmes stratégiques et politiques en Asie du Nord-est.
Depuis 2000, je suis chercheur à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), et depuis 2006 installé à Taïwan. Ces quatre dernières années asiatiques furent entrecoupées d’un séjour d’un an à l’Université du Québec à Montréal (Canada), où j’étais professeur-invité. Mes travaux de ces dernières années ont porté sur la politique étrangère des États-Unis, l’Asie du Nord-est, les questions nucléaires et sécuritaires contemporaines.
J’ai publié à cet égard une vingtaine d’ouvrages, et travaille actuellement sur un projet de recherche sur les relations Chine – États-Unis. Enfin, à l’occasion, et dans le cadre d’une de mes autres activités, rédacteur en chef de la revue trimestrielle Monde chinois, j’explore la Chine, en particulier les provinces du sud. Une existence entière ne suffit pas pour explorer ce pays gigantesque, magnifique, et tellement diversifié.
Pourquoi avoir décidé d’écrire « Chine, la grande séduction. Essai sur le soft power chinois » ?
Ce projet d’ouvrage est né d’un séjour à Washington et de rencontres avec plusieurs experts américains de la Chine. Dans tous leurs exposés, le soft power chinois revenait avec insistance, comme s’il s’agissait d’une véritable obsession. J’avais entendu parler du concept, porté par ailleurs au rang de véritable politique depuis le congrès du PCC en 2007, mais je n’imaginais pas jusqu’alors à quel point il était suivi de près aux États-Unis.
Sans doute l’avais-je trop rapidement rangé dans la même catégorie que les déclarations politiques chinoises de type « société harmonieuse » ou « ascension pacifique« , sans m’interroger d’avantage sur la manière avec laquelle les dirigeants chinois sont parvenus à se réapproprier le concept de Joseph Nye (qui au passage n’est pas vraiment un concept, ce qui explique en grande partie pourquoi il a pu être réinterprété).
En poussant les recherches sur le sujet, j’ai réalisé l’absence totale de documents en Français, et de là est née l’idée de combler ce déficit. Cet ouvrage ne prétend pas à l’exhaustivité, mais est une sorte d’invitation à ne pas laisser échapper une réalité qui s’impose de plus en plus, et que nos partenaires suivent de près. Je réalise que depuis que le livre est sorti, il y a plus d’un an, le phénomène du soft power chinois à commencer à se développer dans le monde francophone, et les études sur le sujet sont désormais plus nombreuses.
Cet ouvrage n’est qu’une modeste contribution à cet édifice, mais elle était sans doute nécessaire, notamment dans sa capacité à s’adresser non pas uniquement aux experts de la Chine contemporaine, mais plus largement aux décideurs politiques, aux journalistes et même à l’opinion publique, par son ton direct et accessible. Il reste encore beaucoup à écrire sur ce sujet, et l’un des prochains dossiers de la revue Monde chinois sera d’ailleurs consacré au soft power chinois.
Quelles ont été les principales problématiques de ce livre, et à qui est-il destiné ?
Le principe de base de ce livre est d’offrir une vue d’ensemble du soft power chinois, d’expliquer en quoi il s’agit d’une réalité (de multiples observateurs continuant à en nier l’existence), et ce que cela implique dans la relation avec les pays en développement.
Il s’agit également de mettre en avant une série de points qui devront faire l’objet d’une attention suivie dans les prochaines années, que ce soit la relation Chine – États-Unis, la montée en puissance de l’influence chinoise dans certains continents, les risques d’arrogance, et plus fondamentalement les questions posées par l’arrivée sur le devant de la scène internationale d’un pays qui n’est pas une démocratie, ne pose pas de conditions politiques à son partenariat avec des pays en développement (en apparence du moins) et est aujourd’hui la seule puissance mondiale disposant de moyens lui permettant de financer sa stratégie de séduction.
Je me suis efforcé dans ce livre de décrire les outils du soft power chinois, les cibles qui sont privilégiées dans la stratégie d’investissements de Pékin (avec des chapitres sur l’Afrique, l’Asie du Sud-est, l’Amérique latine et le Moyen-Orient), les limites du soft power – notamment les réactions de Washington – mais aussi de quelle manière cette attitude décomplexée de la Chine se traduit par un sentiment de confiance renforcé au sein de la population.
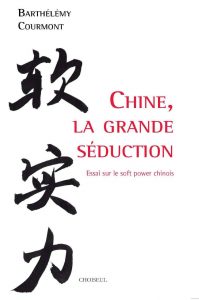 Le soft power chinois est ainsi destiné aux Chinois eux-mêmes, avant de s’exporter. Toutes ces pistes de réflexion composent la toile qu’est le soft power chinois, et ses particularités qui le distinguent des stratégies d’influence des autres grandes puissances.
Le soft power chinois est ainsi destiné aux Chinois eux-mêmes, avant de s’exporter. Toutes ces pistes de réflexion composent la toile qu’est le soft power chinois, et ses particularités qui le distinguent des stratégies d’influence des autres grandes puissances.
Enfin, comme je le disais précédemment, ce livre est volontairement destiné au grand public, son objectif étant de faire comprendre les réalités politiques de la Chine contemporaine, sans parti-pris (ce qui est trop rare sur la Chine). Il ne s’agit ni d’un brûlot anti-Pékin, ni d’une contemplation ébahie de la montée en puissance de la Chine. Le ton est incisif, mais il n’est jamais caricatural.
Peut-on parler d’impérialisme chinois, est-ce une forme de hard power ?
C’est une bonne question. La question de l’identification d’un impérialisme chinois, ou néo-impérialiste, est intimement liée à l’appréciation du régime chinois dans les démocraties occidentales. Et de son côté, la Chine qualifie également volontiers l’attitude des puissances occidentales, les États-Unis en tête, de néo-impérialisme.
Il y a donc une forme de confrontation rhétorique sur ce point. Mais dans les faits, reconnaissons que si le principe d’un impérialisme chinois semble quelque peu exagéré compte-tenu de l’absence de pressions militaires sur d’autres pays, celui-ci s’impose malgré tout peu à peu en faisant usage d’autres outils, notamment la puissance des investissements. De cette manière, la Chine pratique une sorte de hard power, mais avec des moyens qui relèvent plutôt du soft power.
Ainsi, quand Pékin ne soumet pas de conditionnalité politique à son aide économique, elle impose quand même un modèle. De même, il serait naïf de croire que les pays qui bénéficient des investissements chinois disposent d’une marge de manœuvre importante dans les jugements qu’ils peuvent porter sur ce pays. Et cette tendance ira certainement en s’accentuant.
La Chine est elle encore communiste ?
Si la Chine était une démocratie, cette question figurerait certainement au programme des congrès du PCC. Mais comme les dirigeants sont bien embarrassés pour y répondre, elle risque de rester taboue encore longtemps. Plus sérieusement, l’évolution du communisme en Chine a été perpétuelle, à l’inverse des démocraties populaires d’Europe centrale et orientale, où l’immobilisme était érigé au rang de vertu, ce qui au passage leur fut fatal.
Certes, ces évolutions ne furent pas toujours bénéfiques. On pense notamment à la dérive criminelle et aberrante, quand on la regarde a posteriori, de la Révolution culturelle. Mais depuis que Deng Xiaoping a repris le pouvoir en main en 1978, les réformes ont été à l’origine des succès de ce pays, et il serait erroné de considérer que la Chine est un pays conservateur depuis trois décennies.
D’ailleurs, la Révolution culturelle fut d’une certaine manière, et paradoxalement, la dernière manifestation du conservatisme en Chine. En trois décennies, les politiques de développement ont considérablement évolué, le libéralisme économique s’est imposé, et les débats au sein du PCC sont plus réalistes, et moins emprunts d’une idéologie qui a trop longtemps laissé ce pays dans le marasme.
Mao Zedong craignait plus que tout la montée en puissance d’une sorte de Krouchtchev chinois après sa mort, et on peut dire qu’il a fait preuve d’une certaine clairvoyance à cet égard, tant les orientations de la Chine contemporaine l’éloignent considérablement du testament politique qu’il a laissé.
D’un point de vue politique, la Chine reste évidemment communiste, mais quel sens donner à cette appellation ? Le parti règne sans partage, et ses référents idéologiques sont inchangés. Mais dans les faits, la Chine est parvenue à proposer un modèle dual qui, s’il semble paradoxal à de multiples égards, lui a malgré tout permis un développement que peu d’observateurs pouvaient prévoir à la mort de Mao, en 1976.
Il a toujours eu une spécificité chinoise dans le communisme, mais celle-ci s’est accentuée en marge du développement et du libéralisme économique. Et ce mouvement perpétuel nous invite à considérer que le communisme chinois continuera d’évoluer.
La Chine peut-elle se diriger vers une social-démocratie ?
C’est sans doute l’un des principaux défis du régime chinois, en particulier une fois que ce pays sera parvenu à un niveau de puissance économique lui permettant de développer de manière plus intense sa propre société. Sur ce point, il convient de noter que la Chine a fait d’importants progrès au cours des dernières années, et la crise économique internationale actuelle a même été perçue comme une opportunité pour accélérer les réformes en vue de développer la consommation intérieure, et donc le niveau de vie des Chinois.
Reste le volet démocratie. Il ne faut pas s’attendre à un bouleversement en profondeur des institutions politiques en Chine dans les prochaines années, et à une révolution démocratique. Un pays qui va dans le bon sens n’a aucune raison de modifier la nature de son régime, et à moins de voir la Chine connaître un essoufflement brutal de sa croissance (tant de fois prophétisé, à tort), le régime ne sera pas modifié.
Mais cela n’empêche pas la mise en place progressive de réformes, au niveau local notamment, afin de lutter plus efficacement contre la corruption et les inégalités. En fait, on ne le répète pas assez souvent, mais la Chine regarde avec attention ce que l’autre Chine, Taïwan, a été en mesure de produire au cours des dernières décennies en matière de réformes politiques. La démocratie taïwanaise n’a aujourd’hui absolument rien à voir avec le pouvoir autoritaire de Chiang Kai-shek.
Mais les réformes se sont imposées en douceur, petit à petit, sans bouleversement brutal, et en marge d’un développement économique spectaculaire. Un tel scénario n’est pas à exclure dans le cas chinois, et s’il prendra des décennies, il pourrait permettre à ce pays de s’orienter en douceur vers la démocratie, sans que le PCC en fasse les frais.
Mais restons lucide, d’autres scénarios sont également possibles, notamment une sorte de statu quo autoritaire. C’est pourquoi il faut suivre de près les orientations politiques du PCC, et notamment les choix qui seront privilégiés par la nouvelle génération de dirigeants qui s’imposera après 2012.
Pensez vous que la Chine peut mettre en place son modèle de démocratie, loin du modèle occidental ?
Pour qu’elle mette en place un modèle de démocratie, il faudrait déjà qu’elle en soit une ! Et si la Chine devient une démocratie, la question ne se posera pas. Ce qui est en revanche plus problématique, c’est de savoir quel modèle de gouvernance (mais aussi de développement) la Chine va souhaiter promouvoir.
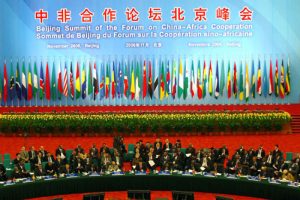
Et quelles règles elle souhaite respecter, ou non. Si la Chine devient une grande puissance « comme les autres« , sans chercher à bouleverser les mécanismes actuels en s’intégrant au G20 et à l’OMC (ce qui est de facto le cas, mais la question est de savoir si Pékin sera un membre comme les autres d ces institutions), ni même ce qu’on qualifie de consensus de Washington, elle deviendra première puissance mondiale en douceur, sans faire de vague, mais s’exposera dans le même temps à des paradoxes internes de plus en plus grands, qui pourraient avoir raison du régime.
A l’inverse, si la Chine décide de ne pas respecter les règles internationales, et part du principe que démocratie et capacité d’influence ne sont pas nécessairement associées, on verra alors se formuler un consensus de Pékin qui sera une véritable compétition pour le consensus de Washington, l’émergence d’un autre modèle. L’idée a été évoquée à plusieurs reprises ces dernières années par des observateurs occidentaux, notamment Joshua Cooper Ramo et Stefan Halper, qui a récemment publié un ouvrage intitulé The Beijing Consensus.
Ce pourrait être la prochaine étape, après le soft power. Pour le moment, les autorités chinoises nient toute volonté de mettre en place un consensus de Pékin et qualifient ce dernier de création de l’Occident. Mais ils n’en pensaient pas moins du soft power il y a vingt ans, quand il fut formulé par Joseph Nye.
Vous avez écrit un article, sur le prix Confucius, intitulé « Prix Confucius : une farce qui risque de devenir sérieuse« . N’est ce pas un moyen pour Pékin de tordre le cou à la dominance du monde intellectuel occidental en Asie, et en Afrique, et de désormais prendre en compte les pays en voie de développement ? Comme vous le concluez : « Ce geste fait partie de la grande stratégie de Pékin en direction des régions en développement, avec un discours qui dénonce la main mise de l’Occident sur les valeurs universelles, et qui reçoit un écho favorable, il faut le reconnaître, dans de nombreux pays« .
L’annonce de la création du Prix Confucius pour la Paix a été reçue en Occident comme une mauvaise plaisanterie, et rapidement comparée aux tentatives avortées de l’Allemagne nazie et de l’URSS. Cela s’explique par le soutien, légitime d’ailleurs, des démocraties occidentales à l’égard de Liu Xiaobo, le lauréat du Prix Nobel de la Paix, et le fait que cette création chinoise soit immédiatement considérée comme une réponse à ce que Pékin estime être une attaque du régime chinois.
Je crois cependant qu’il ne faut pas sous-estimer la force de ce prix, en ce que la démarche chinoise est aujourd’hui suivie par de nombreux pays, qui portent un regard désapprobateur sur l’Occident et les valeurs qu’il cherche à véhiculer – et en certains cas imposer. De nombreux pays ont d’ailleurs manifesté leur soutien à Pékin, en saluant la naissance du Prix Confucius et en refusant d’assister à la remise du Prix Nobel de Liu Xiaobo.
C’est une situation inédite et qui pose problème pour la crédibilité internationale du Prix Nobel, et impose une réalité trop souvent sous-estimée, que dans de nombreuses régions, ce prix est considéré comme la manifestation d’un néo-impérialisme de l’Occident.
Le choix du lauréat est également significatif. Si Pékin avait choisi un membre du PCC, un dirigeant étranger proche de Pékin mais diabolisé par l’Occident (Chavez par exemple), ou même Julian Assange, pour faire un pied de nez (le fondateur de Wikileaks était, comme Liu Xiaobo, incarcéré lors de la remise du prix), le Prix Confucius n’aurait pas eu une grande crédibilité, et aurait effectivement été considéré comme une farce sans lendemain.
Mais en choisissant le taïwanais Lien Chan, ancien vice-président et artisan du rapprochement avec Pékin (mais qu’on ne saurait qualifier de pro-chinois !), qui d’ailleurs a eu l’intelligence de ne pas aller recevoir son prix à Pékin sans pour autant le refuser, la Chine envoie un message politique clair. La pérennité de ce prix n’est pas à exclure, et je dirais même qu’elle est fortement probable.
C’est pourquoi j’ai rédigé ce texte, quelque peu à contre-courant de la plupart des commentaires qui ont été faits sur cette question, et qui se rangèrent de manière à mon sens à la fois hâtive et trop alignée sur une pensée unique se cachant derrière un argument selon lequel le Prix Nobel serait sacralisé et toute forme de dissidence montrée du doigt.
L’un des grands défis pour l’Occident consistera à prendre la mesure de son extraordinaire impopularité dans le reste du monde, une situation que la Chine a parfaitement assimilée, et qu’elle utilise à son profit. On peut continuer à le nier, mais il faudra en assumer les conséquences.
Le monde a besoin de la Chine, et la Chine a besoin du monde, n’y a-t-il pas un moyen de cohabiter ?
La question n’est pas tant de savoir s’il y a un moyen de cohabiter, mais s’il existe une autre option. Or, devant la puissance de la Chine (qui bien entendu a besoin du monde pour pérenniser ses succès), et les perspectives d’avenir qui donnent le vertige, ce pays ayant rattrapé l’une après l’autre l’ensemble des grandes puissances économiques mondiales, et plus encore si on ajoute à cela la population de ce pays, il est évident qu’il est désormais impensable de se passer de la Chine, et de ne pas accepter son intégration pleine et entière dans le cercle des grandes puissances.
On ne peut donc plus dire non à la Chine, ce qui en soit est problématique, notamment pour des démocraties qui se voient contraintes de courber l’échine, malgré leurs profondes réticences à l’égard du régime chinois. A cet égard, le principe du sticky power (qu’on pourrait traduire par « puissance aimante« , gluante n’étant pas vraiment approprié ici), défini par Walter Russel Mead il y a quelques années, semble parfaitement coller – c’est le cas de le dire – à l’exemple chinois.
Les autres pays ne vouent pas nécessairement une admiration pour Pékin, mais ils n’ont d’autre choix que de s’en rapprocher. L’exemple des pays d’Asie du Nord-est, où on trouve (et c’est une des spécificités chinoises) les principaux rivaux de Pékin, du Japon à Taïwan, en passant par la Corée du Sud, est éclairant. Ces pays continuent de se méfier de la Chine, mais ils s’en sont considérablement rapprochés. Séoul et Tokyo ont engagé un dialogue avec Pékin sur les réponses à la crise économique, et certains se risquent déjà à évoquer la possibilité d’une intégration économique.
De son côté, Taïwan a signé une série d’accords, dont l’ECFA (Economic Cooperation Framework Agreement), qui marque un rapprochement historique entre les deux entités rivales depuis 1949, au prétexte qu’il est impossible désormais de tourner le dos à Pékin. Cette force d’attraction du sticky power se retrouve sur tous les continents, et les démocraties occidentales ne font pas exception. Certains pourront appeler cela une cohabitation, je pense pour ma part qu’il s’agit plutôt d’une victoire pour Pékin qui peut ainsi non seulement continuer à s’appuyer sur le reste du monde pour monter en puissance, et dans le même temps se faire accepter sans avoir à faire la moindre concession.
Comment définiriez le capitalisme d’État chinois, quels sont les moyens utilisés par Pékin ?
Les pouvoirs publics chinois sont parvenus à établir un équilibre subtil entre la libéralisation économique et le maintien d’un régime autoritaire. Cet équilibre est assuré par les chiffres de la croissance, et est donc associé aux succès économiques, ce qui impose bien entendu des interrogations sur ses limites. Il s’agit donc d’un équilibre fragile.
Sur la scène internationale, Pékin ne se montre pas comme un acteur politique et idéologique, mais comme une puissance économique, et c’est cette puissance qui lui permet, par voie de conséquence, d’influencer les décisions politiques. Mais l’idéologie est bel et bien mise de côté.
Enfin, il ne faut pas entendre le principe de capitalisme d’État en Chine comme on l’entendrait en Occident. La puissance économique de la Chine s’appuie en grande partie sur une multitude de petites entreprises, et moins sur des géants de l’industrie étroitement contrôlés par l’État. C’est au niveau des régulations et des exportations que l’État chinois assure son contrôle. Là encore, on note donc des spécificités chinoises, qu’il est important de saisir si on veut éviter les erreurs de jugement sur ce pays.
Propos recueillis par Céline Tabou
[…] soft-power […]
[…] ligne suivie par les autorités chinoise, en parallèle du « soft power » imposé depuis quelques […]
[…] par certains esprits critiques comme du néo-impérialisme quand il s’exerce à l’échelle d’un État, le soft power vise assurément à prendre des […]
[…] de la Chine dans le domaine de la conquête spatiale visent à renforcer le prestige local et le soft-power national, plutôt qu’à étendre la puissance […]
[…] une interview à Atlantico, Barthélémy Courmont est revenu sur le rapport publié la semaine dernière par le département de la défense […]